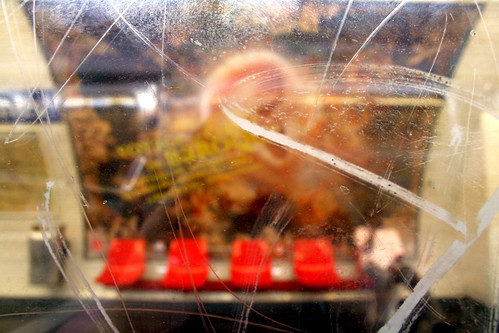Passagère

©Aurélie Zara
J’ignore sur quelle sorte de pont ou d’esquif je poursuis ma traversée, arche ou passerelle, bac ou caravelle. Quelle que soit ma route, elle n’a qu’un sens, comme celle des astres. Mais au milieu de ma révolution je peux aller à reculons et regarder en arrière, affrontée à un mur invisible qui me repousse vers mon couchant. Nulle halte n’est permise, l’océan n’est jamais étale, le vent jamais ne tombe. Mer belle ou démontée, ballottée ou arrimée à la barre, j’avance, la peur au ventre ou dans l’ivresse de l’instant.
Passagers
…nous savions tous ce que nous ne savions même plus que nous sommes seulement nos passagers et clandestins encore – sans images sans espoirs que ferons-nous de nous à nous-mêmes amarrés ?
Daniel Bourrion, « Chamane«
Je cours après un rêve
Je cours après un rêve dans lequel je courais après des mots qui commençaient par : Déjà la brume s’est levée…
Au long souffle du soir
Au long souffle du soir, je tends la main vers toi. Tu ne m’as pas vue, tout entier ravi dans la contemplation d’une mésange qui s’accroche à ce mur de pierres, dans le jardin d’à côté, les ailes frémissantes dans l’air fraîchissant.
Le dernier rêve
Elle a ouvert les yeux.
Elle voit le pâle silence. Elle entend le chuintement des couleurs et des tons qui se fondent. La fenêtre. Les objets ne sont plus objets ils sont mêlés inextricablement au sol aux murs à l’air… Air très dense ici empreinte de leurs formes familières là raréfié… irrespirable… La fenêtre.
La fenêtre est ouverte… la brume nocturne a envahi la chambre… Tout est immobile sauf les rideaux… la fenêtre… qui ondulent…
Elle se lève… Spectre dans sa longue robe blanche, une voix l’appelle… la fenêtre… la fenêtre… Elle est tirée vers la fenêtre, une voix ténue, imperceptible et démesurée dans le silence qui suinte des murs, du plafond blême, absorbé par le grand miroir, la fenêtre. Elle s’avance vers la fenêtre ouverte vers la fraîcheur qui ranime les contours. La lune laisse évaporer sa lumière. Déjà elle est au-delà de la fenêtre, déjà elle glisse lentement dans le vide. Et sa robe blanche, son linceul, l’étoile mordorée de ses cheveux, une nouvelle fleur illumine le jardin…
Il y eut un bruit étouffé.
Elle ouvrit les yeux.
Elle entendit, dans le silence, son cœur battant. Les couleurs restaient incertaines. Les objets recouvraient peu à peu leur aspect familier et leurs contours exacts : le bureau avec son amoncellement de feuilles noircies ; ici, le guéridon ; là, le grand miroir réfléchissant la lumière du réverbère, dehors.
La fenêtre était fermée. Tout était immobile, sauf l’aiguille effilée du réveil, poursuivant discrètement les secondes.
Elle se leva. Une voix ? Non, juste son souffle au rythme oppressant. Et la fenêtre était fermée. Elle sourit, la fenêtre était fermée.
Comme pour exorciser un souvenir angoissant, elle l’ouvrit, se pencha : en bas, un grand linceul blanc illuminait le jardin.
… Son cœur s’est arrêté.
(janvier 1992)
Je laisse les mots s’enfanter
Je laisse les mots s’enfanter presque seuls, avec l’intervention parfois minimale de la rature, d’une reprise d’un rythme un peu maladroit ou d’une multiplication toujours retenue d’une phrase après l’autre. Je ne sais si cette écriture quotidienne me contraint ou me libère ou les deux ensemble, pensée naïve de qui refuse de réfléchir de manière littéraire.
Ce que je vois, c’est que, tout en restant enfermée (c’est comme cela que je le perçois) dans une forme, j’avance en moi-même, mon écriture s’affermit et l’émotion rayonne d’une vibration différente. Je regarde, surprise, ces mots qui s’échappent, et je les regarde enfin avec la bienveillance qu’on doit aux enfants qui nous habitent.
Je ne sais si je dois « construire un projet littéraire ». Ou, les yeux fermés, laisser se construire ce qui sera peut-être un jour une œuvre, ou juste un ensemble de fragments épars et orphelins, privés de l’attention d’un auteur qui aurait créé un lien, un fil d’Ariane dans le labyrinthe d’une vie.
Mais qu’importe. J’ai retrouvé le plaisir d’écrire les mots qui me disent et vous parlent. Cultiver, jardiner, faire croître, voilà mon projet en ces jours nouveaux qui déclinent.
Rouge pluie
Ta vie vécue comme la coupole d’un jour inversé
Tu m’as appelée dans ce rêve de la ville
Quand pourtant tu sais que je bats la campagne
Quand la guerre couve toujours dans ses braises
Et je m’y chauffe les mains tendues
Malgré moi
Ta porte réticente à me laisser entrer
Claque au vent immobile de ton absence
Et sur le mur de ta chambre j’ai vu
Cet étrange panorama c’est moi
Que j’y vois assise avec ma fille
Elle s’endort soudain à même le sol
Aspirée dans un jeu que nous avions inventé
Ensemble cette course dans le champ
Et cette cabane de drap blanc
Et cette bataille silencieuse
Sous la coupole des jours perdus
Sentinelle
Sentinelle
Tu
Coupes
Les mots
D’ici
Pâles
Spectres
Dans ta guérite
Étroite
Verticale
Gisante
Tu es
Droite
Comme le i
De l’œil
Quand tu
Cris
Qui va là?
[Ici]
Petite pause le temps de vous retrouver de l’autre côté du miroir
Tout est dans le titre.
Le temps de partir. Le temps d’arriver.
Et je vous retrouve ici, enfin je me comprends. Je serai là-bas, ça sera devenu ici. Tandis que ce lieu-ci reste indéfiniment ici qu’on soit ici ou là-bas. Bref, il est temps que je fasse une pause. Que je me concentre sur les derniers préparatifs.
Enfin si vous le souhaitez vous pouvez rester un peu ici pendant que je ne suis pas là, entre ici et là-bas, hein, si ça vous dit.
Y a des gens très sympas qui fréquentent cet endroit. Je laisse du thé et des petits gâteaux.
Allez, cette fois je me sauve.
A très bientôt.
Morceaux du temps
J’ai réuni les fragments d’un vase morcelé. Chaque morceau placé l’un à côté de l’autre forme la mosaïque d’un temps que la mer a usé comme le sable. Les mains devant les yeux, je n’ose pas laisser s’imprimer en moi l’image ainsi formée.
En vidant la grande armoire, j’ai trouvé un petit miroir aux biseaux chantournés. Sa surface rayée appuie sur ma poitrine, m’imposant le reflet de la faille qui me traverse. De vieilles lettres ont refait surface, insensibles à la blessure ouverte, comme les eaux de la mer Morte.
Papillons de nuit reviennent me hanter, papillons blancs épinglés au mur de ma raison. Laissez-moi dormir et rêver d’une maison.
Vivement le départ
La fatigue m’emporte. Mon corps me porte encore. Courbe du dos enroulée en fœtus.
Architecture de cartons, instables gratte-ciels, cartons rebelles à moitié pleins à moitié vide.
Va et vient, paperasse, circulation accélérée. Faire le vide. Remplir, vider.
Relire de vieilles lettres et pleurer. Regarder l’avenir. Se redresser.
Vivement le départ. Dormir léger.
Qui écoute?
Quitter la ville
Le dos d’un enfant s’appuie au réverbère. Comme on entend le claquement des talons sur le bitume des trottoirs et je passe. La lune s’est accrochée aux frondaisons des platanes, têtes réduites. Filet lâche au matin bruissant. Bientôt, je m’échapperai de la ville, mais prisonnière je crains de rester, qui s’est insinuée dans mes veines. Adieu. Je respire.
La fenêtre haute vue sur étoiles rectangulaires aux crépuscules qui ne s’éteignent pas. Toutes lumières jaunes tournées vers le bas, factices enceintes sans portes. Tu ne t’échapperas pas. Seule la lune arrive à percer la muraille, un judas sur l’autre, intrus, étranger. Adieu. Je me dessille.
Une voix est couverte par les cris d’enfants. L’air tremble et vibre, le plomb se transforme parfois en or, le soir, dans le grondement d’une mer sans ressac. J’y lance des vœux, hameçons émoussés en forme de nuages, le regard posé devant moi, sur le mur. Un coin de l’affiche décollé comme invitation à tendre la main. Adieu. J’entends.
J’irai toucher le paysage des terres finies, sans cesse érodées. J’irai rendre l’humus à la terre. J’irai dormir en ce jardin ensauvagé piqueté d’étoiles.
Adieu.
Je quitte bientôt la ville qui m’a enfantée.
©Brigitte Célérier